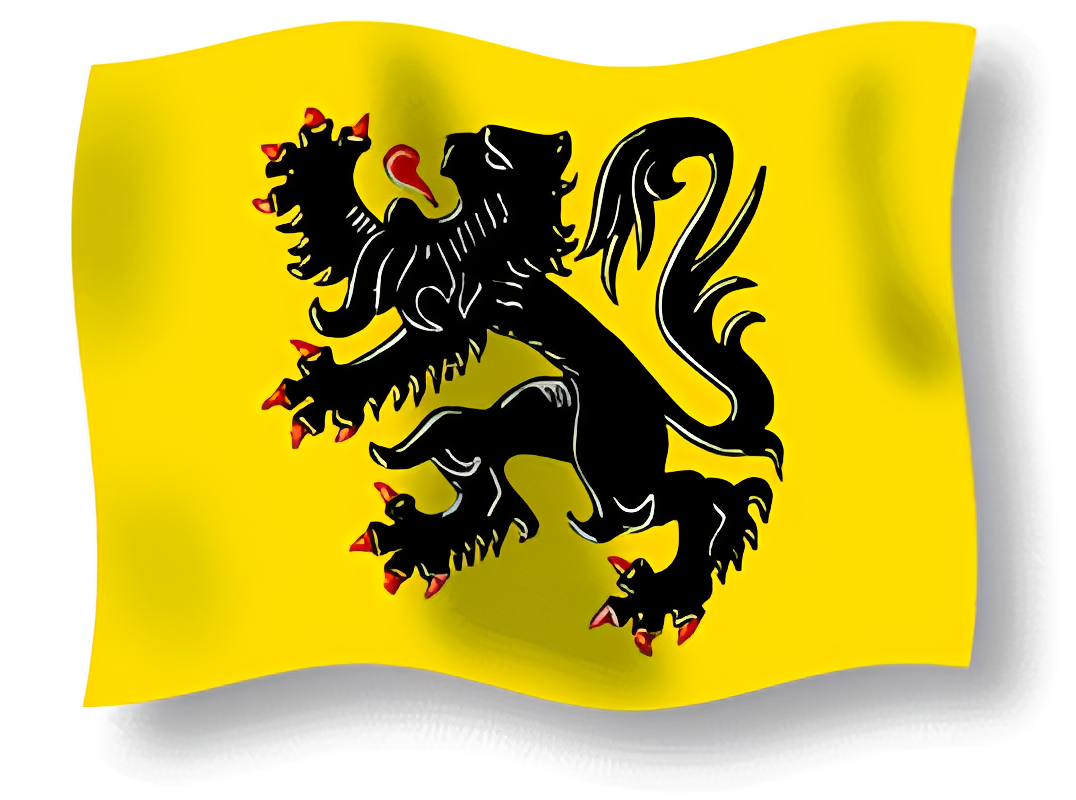Notice sur Fort-Mardyck
Par le docteur Louis Lancry, 1890
« Une idée civilisatrice jaillit un jour du cerveau de Louis XIV, au milieu de ses mille et une préoccupations de conquêtes, de batailles, de blocus, de sièges, de fêtes. Le souvenir de Mardyck n’était pas sorti de sa mémoire (allusion à deux séjours de Louis XIV à Mardyck, en 1658 et en 1662), et le Grand Roi ordonna spontanément à un de ses ministres, de faire un appel à ses sujets pour former une colonie de marins dans la Flandre maritime. Il indiqua alors du doigt, sur la carte, le lieu qu’il avait choisi. Ce lieu était Mardyck, le sol qu’avait occupé le célèbre fort où ses armes avaient été victorieuses. Le but du roi n’était pas uniquement de peupler cette partie de son royaume ; mais de trouver là sous sa main, en toute occasion, une pépinière de marins dont il comprenait toute l’utilité. Le projet eut un plein succès ; et quatre familles de la Picardie vinrent s’offrir au ministre de la marine. Ces familles étaient de Cucq, village situé à trois lieues ouest de Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de- Calais. Le gouvernement leur accorda les frais de route en 1670. Ils arrivèrent à Mardyck, où on leur fit construire des maisonnettes, en torchis et chaume, qui avaient chacune leur jardinet. On leur paya en outre les frais d’installation ; ils eurent, de plus, la faculté de défricher et d’exploiter ce qu’ils pouvaient, des terres sablonneuses contiguës à leurs habitations. Les noms de ces familles étaient Bénard, Everard, Zoonekindt et Godin. C’était une chose étrange que cette colonie de gens ne parlant que le français, venant s’implanter au centre d’un pays flamand ; car, en 1670, la langue française était très peu en usage à Mardyck et à Dunkerque ; elle était même inconnue à Grande-Synthe et à Petite-Synthe. Telle fut l’origine du hameau des matelots-pêcheurs du Fort-de-Mardyck. »
C’est en ces termes que le très consciencieux auteur de l’Histoire de Mardyck et de la Flandre maritime, Raymond de Bertrand, à qui nous empruntons du reste, pour cette notice, les renseignements purement historiques, après avoir vérifié les plus importants, raconte l’origine de la population qui nous occupe.
Il nous apprend que les quatre familles susnommées formaient un total d’environ trente personnes.
Ce groupe minuscule ne faillit pas à sa mission, et, pour répondre aux espérances royales, non moins que pour satisfaire à la loi Génésiaque, il se hâta de croître et de multiplier.
En 1677, soit sept ans après son émigration, la petite colonie compte déjà 30 familles. Il y a là une progression évidemment impossible, si l’on n’admet pas que les premiers colons en ont appelé d’autres, soit du pays d’origine, soit même des environs.
La pêche du poisson frais constituait l’occupation à peu près exclusive de la population mâle, en temps de paix. Malheureusement, les périodes de paix, sous Louis XIV, n’étaient jamais longues.
Vinrent les grandes guerres maritimes contre l’Angleterre ; la vaillante petite colonie fournit aux corsaires Dunkerquois, aux escadres de Jean Bart, des marins intrépides, mais non sans ressentir elle-même les effets de cette dépense en hommes.
Vers la fin du règne, lors de la création du port de Mardyck, qui devait, dans la pensée de Louis XIV, remplacer celui de Dunkerque comblé à la suite des stipulations du traité d’Utrecht (1713), elle prend un nouvel essor ; mais, sur les injonctions des Anglais, le port dut bientôt être comblé, et les écluses, ces superbes écluses qui avaient excité l’admiration de Pierre le Grand, démolies.
Les Matelots-Pêcheurs n’en continuent pas moins leur industrie, et deviennent les pourvoyeurs, en poissons, des marchés du pays.
Le recrutement de 1729 accuse 102 individus pour la partie du hameau qui dépendait de Petite-Synthe[1].
On y trouve des noms nouveaux, tels que les Maquet, les Turbau (aujourd’hui Turbot), les Bouchard, etc…., noms essentiellement français, comme on le voit, noms qui existent encore dans les environs de Berck-sur-Mer et qui prouvent que les premiers colons émigrés avaient été suivis d’autres colons venant eux aussi des confins de la Picardie.
En 1730, la portion du hameau qui dépendait de Petite-Synthe, comptait 138 individus, et « estimant à ce chiffre le quartier qui dépendait de Grande-Synthe, dit Raymond de Bertrand, on voit que la communauté devait contenir au moins 276 âmes. »
En 1742, elle fournit 62 hommes au bataillon des milices destinées à la garde des côtes de la mer, depuis Gravelines jusqu’aux frontières belges. Ce chiffre semble témoigner à cette époque d’une véritable prospérité.
Il ne dut point toujours en être ainsi, car, en 1745, la misère est si grande au hameau des Matelots-Pêcheurs, les enfants sans proches parents y sont si nombreux, que ces pauvres gens se décident à présenter une demande pour être secourus par les communes dont ils dépendent. Celles-ci s’y refusent, en déclarant que « la demande en question était atroce et injuste, exorbitante et inouïe… les habitants de Fort-Mardyck formant une colonie qui était venue s’établir dans les dunes pour y faire la pèche, et s’y tenant du reste indépendants des autres habitants du pays[2]. »
Les Matelots-Pêcheurs se le tiennent pour dit.
En 1773, un acte authentique, rédigé en conseil des ministres, reconnaît à ces braves gens des droits qui jusqu’alors reposaient sur la seule parole royale ; ce qui ne les empêchait pas du reste, de se trouver, à quelque temps de là, en butte aux tracasseries et aux injustices de plusieurs grands seigneurs du pays, le comte de la Morlière, le Vicomte de Gand, Ceux-ci avaient obtenu du roi la concession des relais de mer, à charge de respecter les droits des Matelots-Pécheurs, ce qu’ils ne firent point. Comme nos braves colons n’étaient point d’humeur à rien céder de droits acquis et solennellement reconnus, ils réclamèrent énergiquement, décidés à abandonner le pays et à émigrer en Hollande, si on ne leur donnait point satisfaction.
Le roi Louis XV, à qui ils avaient transmis leur requête, n’eut garde de se priver des services de ces marins d’élite, et leur fit rendre pleine et entière justice[3].
Cette période est peut-être la plus pénible de toutes celles qu’ait traversées la communauté fort-mardyckoise. « La pêche du poisson frais tomba tout-à-coup ; plusieurs familles quittèrent la concession où il ne leur était plus possible de gagner leur vie », à ce point, qu’en 1783, la population était tombée à 200 individus, de 276 qu’elle pouvait compter en 1736.
Nonobstant toutes ces traverses, Fort-Mardyck est érigé eu commune en 1791. Disons tout de suite qu’en 1800, ce titre lui est enlevé. Ou le rattache alors à Mardyck[4] ; ce n’est que bien plus tard, en 1867, que Fort-Mardyck recouvrera son autonomie communale.
Voici, dans ce siècle, quelques recensements de la population de Fort-Mardyck :
En 1836 : 87 maisons, 97 ménages et 459 habitants
En 1841 : 91 maisons, 96 ménages et 432 habitants[5]
En 1846 : 113 maisons, 111 ménages et 558 habitants
En 1851 : 128 maisons, 120 ménages et 615 habitants
En 1886 : 1481 habitants
L’Histoire de Mardyck, par Raymond de Bertrand, s’arrête en 1852, Depuis cette époque, le hameau des Matelots-Pêcheurs n’a fait que grandir et prospérer, de cette prospérité sur laquelle peuvent compter les races saines et fortes qui acceptent dans toute sa plénitude la loi du travail.
Cependant, une épreuve d’un genre tout nouveau attendait les Fort-Mardyckois ; hâtons-nous de dire qu’ils en triomphèrent, grâce à leur tempérament robuste.
On vit un jour arriver à Fort-Mardyck un riche philanthrope qui apportait aux gens du pays, dans les pans de sa redingote, « le bien-être, la civilisation et le progrès ! » Cet homme, possesseur d’une grande fortune, très sympathique aux marins, avait voulu faire quelque chose pour eux, et s’était arrêté à l’idée de construire à Fort-Mardyck une sorte d’asile ou d’hospice pour les invalides de la mer.
Certes, l’idée était grande, généreuse ; son auteur ne doutait pas un seul instant qu’elle ne fût accueillie avec enthousiasme par les marins de l’endroit. Ne tombait-il point là comme une Providence ? Et la création de ce grand établissement hospitalier ne provoquerait-elle point dans le pays des allées et venues dont il bénéficierait, dont il retirerait une aisance et un bien-être relatifs ?
A son grand étonnement, l’enthousiasme n’éclata pas. Nos Fort-Mardyckois, en gens à qui l’on vient proposer une affaire grosse de conséquences, demandèrent huit jours pour réfléchir.
Durant ces huit jours, on s’assembla, on discuta, on pesa le pour et le contre ; car on trouva qu’il y avait contre ce projet plus d’une raison.
Qu’allait-on faire en effet ? — Leur venir en aide dans le malheur ? C’était bien. — Recueillir leurs vieillards et les soigner ? Rien de mieux.
Mais on ferait encore autre chose. On mettrait d’abord un pied chez eux ; on en mettrait bientôt quatre.
L’étranger ne tarderait pas à fouler en maître cette terre, leur patrimoine séculaire et inaliénable, où chacun marchait l’égal de son voisin, dans la vraie liberté et la vraie fraternité ; cette terre qu’ils adorent, plus que le Breton sa Bretagne, et où ils viennent toujours se reposer de leurs nombreuses campagnes d’Islande.
Des messieurs portant chapeau, des terriens, seraient là tous les jours, les coudoyant, les humiliant peut-être. Qui sait ? Peut-être aussi leurs femmes et leurs filles, attirées par l’appât d’industries plus lucratives et plus douces, se détourneraient-elles peu à peu de la pêche, et perdraient-elles de La simplicité de leurs mœurs.
Bref, les Fort-Mardyckois eurent la vision de leur avenir compromis, en tant que groupe social, et de leur indépendance perdue. Ils virent, si ce projet se réalisait, leur sol violé, se couvrant de constructions qui écraseraient leurs humbles maisonnettes ; leur organisation économique, leur orgueil, menacés à bref délai ; l’étranger, le terrien, le bourgeois, installe chez eux avec ses mœurs, son langage, et peut-être sa corruption ; ils virent tout cela.
Peut-être quelque vieux marin, devenu orateur dans des conjonctures aussi graves, leur démontra-t-il, comme jadis P.-L. Courrier aux habitants de Verretz, à propos de la souscription pour le château de Chambord, qu’ils avaient tout à perdre à se frotter au beau monde ; toujours est-il que, d’un commun accord, ils décidèrent de refuser l’offre du riche étranger. Quand celui-ci revint huit jours après, les Fort-Mardyckois, gens simples et sans façons, lui tournèrent le dos[6] ; une légende veut qu’ils lui aient jeté des pierres ; mais j’ai peine à le croire, attendu qu’il n’y a que du sable à Fort-Mardyck.
Ah ! qu’il eût été mieux inspiré, ce bienfaisant étranger, ce philanthrope, si, au lieu d’un hôpital, il leur avait offert des terres en propriété ; des terres qui leur eussent permis de s’étendre, de s’étendre encore, sans craindre d’épuiser cette concession de Louis XIV, qui, forcément, ira se rétrécissant de plus en plus. C’était là le cadeau à leur faire. Un économiste s’en fût douté.
De ce que je viens de raconter, qu’on n’aille point inférer que les Fort-Mardyckois sont gens arriérés, réfractaires à toute idée de progrès et de mieux-être. On se tromperait lourdement. Le progrès, ils l’admettent, mais ont une façon spéciale de l’entendre. Pour eux, ce n’était point progrès et bénéfice que d’admettre dans leur sein un élément étranger qui serait venu contrarier la spontanéité de leur développement, peut-être même y apporter des entraves. Là, où un groupe social, moins vivace et moins fort, moins habitué à se développer en vertu de ses seules forces vives, eût vu une fortune inespérée, ils virent, eux, un danger, une menace pour leur organisation, un risque de déchoir, et ils refusèrent.
Il s’est rencontré des sages à courte vue pour les condamner, et considérer leur refus comme une sottise ; pour nous, et, croyons-nous, pour tout homme habitué à voir les choses d’un point de vue un peu élevé, les Fort-Mardyckois se sont montrés, ce jour-là, tout simplement admirables d’instinct de prévoyance.
Du reste, ces hommes qui refusaient un hôpital, étaient les mêmes qui, dès 1800, sept ans avant que leur village fût érigé en commune, alors, par conséquent, qu’ils étaient livrés à leurs seules ressources, construisaient à leurs frais, les capitaines s’imposant à 100 francs, les matelots à 10 francs par tête, écoles, église et presbytère ; proclamant ainsi, et de la façon la plus éloquente, leur amour du vrai progrès, puisqu’ils s’imposaient volontairement les plus lourds sacrifices pour s’en assurer les deux plus puissants facteurs : l’église et l’école.
Trouverait-on dans toute la France beaucoup de villages ou hameaux, qui, bien avant la loi de l’instruction obligatoire, aient fait preuve d’une pareille initiative ?
Aujourd’hui, le voyageur qui, l’été, suit à pied la route de Dunkerque au Grand-Mardyck, découvre sur sa droite, après avoir marché quelques kilomètres, un village du plus riant aspect.
C’est, à l’écart de la route, entre celle-ci et la mer, comme un semis de pignons blancs, blancs d’une blancheur éblouissante, qui émergent d’une plaine de verdure.
J’ai nommé Fort-Mardyck.
La première impression est des plus favorables à ceux qui l’habitent. Si l’on se détourne de la grande- route, et qu’on entre dans ce village, cette première impression ne fait que s’accentuer. On marche entre des maisonnettes d’une exquise propreté, éparpillées dans le plus gracieux pêlemêle, entourées chacune d’un jardinet clôturé de haies vives sur lesquelles sèchent çà et là des filets de pêche.
Point de chemins tracés d’avance. A part deux routes, dont l’une sert d’entrée au village et gagne directement la mer, et dont l’autre, croisant la première à angle droit, facilite l’accès de l’église et de l’école des garçons, ce ne sont que larges sentiers sablonneux courant entre les habitations, se coupant dans tous les sens, déterminés qu’ils sont par la simple juxtaposition des clôtures verdoyantes.
Sans pousser plus loin cette description, disons tout de suite quelques mots des habitants et du régime sous lequel ils vivent.
Nous le savons d’ores et déjà ; c’est une population de marins. Sur 400 à 450 hommes environ (je ne dis point tous adultes, car on va de bonne heure à la mer à Fort-Mardyck, le plus souvent après la première communion), la grande majorité s’en va chaque année pêcher la morue à Islande ; les autres naviguent au cabotage, ou au long-cours.
Les femmes, en toute saison, vont à la pêche à la crevette, le corps dans l’eau jusqu’à la ceinture. A certains jours de la semaine, elles portent au marché de Dunkerque, dans de lourdes hottes qui les courbent en deux, le produit de cette pèche et celui de leurs jardinets ; et ces rudes travaux ne les empêchent pas d’allaiter leurs nouveau-nés et de veiller à l’entretien de familles souvent nombreuses. — Quelle leçon pour bien des mères françaises !
Grâce à un travail opiniâtre, à une santé qui semble défier la maladie, les Fort-Mardyckois connaîtraient peut-être une aisance relative, si les accidents de mer ne venaient trop souvent ravir quelques chefs à leurs familles, et plonger celles-ci dans une situation voisine de la pauvreté.
J’ai dit voisine, et souligné ce mot. C’est qu’en effet, un Fort-Mardyckois n’est jamais pauvre au sens absolu du terme.
On a vu plus haut que des terres avaient été concédées par Louis XIV aux Matelots-Pêcheurs.
Cette concession de 125 hectares environ, d’abord purement verbale, reconnue ensuite par acte authentique, ils en jouissent toujours, bien que, dans le cours des temps, les terrains en question aient été rognés çà et là, par les communes environnantes.
Or, à tout nouveau couple qui s’établit à Fort-Mardyck, dans certaines conditions déterminées, à savoir : à condition que l’un des conjoints soit né dans la commune, et que le mari soit marin classé (inscrit au registre de l’inscription maritime), la commune concède 6 « carrés » de terre, soit 22 ares, à titre d’usufruit, plus une place déterminée à la côte, pour la pêche au filet.
Ce lopin de terre, sur lequel les nouveaux mariés bâtiront le plus souvent leur maisonnette, est exploité par eux à leur gré sans aucune redevance ; ils peuvent, selon leurs convenances, le louer a quelque voisin, mais non pas le vendre; ainsi que nous l’avons dit, il n’en ont que l’usufruit, et non la propriété.
Et voilà la raison de tous ces jardinets qui font de Fort-Mardyck un oasis, et qui, en même temps qu’ils donnent au village un aspect , si riant, offrent aux familles qui les cultivent de si précieuses ressources, quand une catastrophe vient les frapper.
Ce n’est pas tout. Ce qui reste des terres de la concession, c’est-à-dire une assez grande étendue de terrain, n’est pas, on le conçoit, directement exploité par cette population qui vit de la mer. Ils ont loué ces terres, et le revenu (5.000 fr. environ), qui était autrefois réparti entre toutes les familles du village, est aujourd’hui versé entre les mains d’un percepteur à Dunkerque, et directement affecté, au gré du Conseil municipal de Fort-Mardyck, aux besoins de la commune. C’est sur ce revenu qu’on prélève notamment une somme assez considérable pour venir en aide aux familles nécessiteuses du pays, lesquelles sont presque toujours des familles de sinistrés.
En somme, la commune ne reçoit pas un sou de l’Etat, et ne lui demande rien ; petite république d’une autonomie aussi complète que le comporte notre régime politique; sorte de phalanstère n’ayant rien des vices du premier, où l’initiative et la responsabilité individuelles ne sont pas annihilées, mais développées et agrandies ; où les principes religieux sont en honneur, et rendent aisée la pratique des vertus sociales.
Nous prions le lecteur de ne point voir là un éloge banal, échappé en quelque sorte à notre plume; c’est l’expression de l’exacte vérité.
Les mœurs sont pures à Fort-Mardyck ; c’est à peine si sur 60 naissances, on compte une naissance illégitime, toujours légitimée du reste par un mariage subséquent.
De crimes ou de délits, jamais ici on n’en entendit parler. Le poste de garde-champêtre y est à peu près une sinécure; et pourtant, Dieu sait si les quatre cents marins qui l’habitent pendant six mois de l’année, ont froid aux yeux, et s’ils ont les poings faits pour la lutte.
Cette absence de querelles tient peut-être à une coutume assez répandue dans le pays. Là, le dimanche après vêpres, les hommes se dispersent dans les quatre ou cinq cabarets du village avec leurs femmes et leurs enfants.
Les relations très nombreuses de parenté qui existent entre les habitants, expliquent très bien ces réunions.
Le cabaretier est souvent lui-même un vieux marin retraité avec qui l’on vient causer, en vidant un verre, comme avec un ancien.
Les hommes discutent entre eux de leurs intérêts et de tout ce qui touche à leur profession. Les femmes, beaucoup d’entre elles avec un enfant sur les genoux, causent de leur intérieur ; les jeunes gens font, sous les yeux des parents (ce qui est de règle absolue dans le pays), leur cour aux jeunes filles ; et si parfois quelqu’un, parmi les hommes, élève trop la voix, une voix plus douce et toujours écoutée se fait entendre, et les conversations reprennent au diapason normal.
A 9 heures, les cabarets sont vides ; tout le monde est allé se coucher, car il faut être dispos pour le travail du lendemain, et la marée n’attend pas.
On avouera que le cabaret dans ces conditions, ce n’est plus le cabaret démoralisateur que nous connaissons trop ; ce n’est plus, en quelque sorte, qu’une grande réunion de famille, se faisant chez Pierre plutôt que chez Paul, parce qu’on est plus à l’aise chez le premier, et qu’il est plus à même de vous recevoir. Cette franche gaité ne dure, hélas, qu’un hiver ! Car, à l’inverse de ce qui se passe ailleurs, c’est l’hiver qui est ici la belle saison, celle des réunions, des mariages, des fiançailles. C’est le temps où, par les sentiers boueux ou couverts de neige, on voit rouler et zigzaguer, comme des barques secouées par la houle, des hommes aux carrures athlétiques.
Puis, quand mars arrive, les fronts rembrunissent, la fiancée est moins rieuse, l’épouse ou la mère plus affairée, C’est qu’ici, mars, c’est le signal du départ pour Islande.
Islande !… notre sensualisme bourgeois s’est-il jamais douté de tout ce qu’évoque, au soin de ces populations maritimes, ce nom gros de mystères ?
Pour le touriste flâneur, en quête d’émotions et de spectacles de nature à flatter son dilettantisme, Islande c’est la messe du départ ; c’est la main du prêtre qui s’abaisse pour bénir tous ces vaillants ; c’est la file des barques qui s’avancent vers la haute mer ; ce sont les équipages qui tombent à genoux en franchissant la jetée, et les mouchoirs qui s’agitent, et les femmes qui étouffent leurs sanglots.
Voilà Islande pour les témoins du départ. Pour les autres, c’est-à-dire, pour l’immense majorité, c’est moins encore : un mot, une expression géographique qui éveille machinalement dans l’esprit l’idée de pèche au poisson.
Mais pour eux, pour cette épouse ou cette mère qui reste, pour cet époux ou ce fils qui s’en va, qu’est-ce que l’Islande ?
Pour eux, c’est, ainsi que nous le disait un jour, dans une formule d’un laconisme terrible, un vieux loup de mer qui avait vécu le roman d’Islande, pour eux, c’est « de la glace, des rochers et de la misère ! » — c’est d’abord, un voyage plein de dangers ; puis, pendant six mois, le froid et l’humidité, la brume et la tempête ; c’est, pendant une partie de la saison, tout le temps que le poisson donne, 20 heures de travail, et 4 heures de repos par jour, avec des têtes de morues, des pommes de terre, ou du lard salé pour nourriture.
Islande ! c’est ici, la mère de famille qui tressaille les jours de tempête, se demandant si le coup de vent qui fait trembler sa maison, ne fait point chavirer là- bas la barque qui porte son mari ; puis, si les nouvelles manquent, c’est l’attente qui consume et dévore; l’attente qui tarit ses mamelles et creuse ses yeux.
Et c’est là-bas, bien loin, dans la mer du Nord, la lutte et les privations ; l’héroïsme à trois francs par jour et par tête, sans autre fanfare que celle des vents déchaînés ; les appels désespérés de la cloche et de la trompe de corne à travers les brouillards impénétrables, pour ne point se heurter ; c’est le monstrueux Iceberg que le vent pousse sur vous, et qu’il faut éviter sous peine de mort ; là-bas, enfin, c’est trop souvent le tombeau, avec les eaux noires et profondes pour linceul.
Il y a deux ans, ils furent trente-six qui ne revinrent pas, pour le seul village de Fort-Mardyck ; cent soixante, pour le quartier de Dunkerque.
Qu’importe, après tout ? L’année suivante, les vides seront remplis, et les équipages au complet : et il en va toujours ainsi, la mer, leur âpre nourrice, ne cessant de les dévorer, sans abattre le courage des fils, sans rebuter la constance des mères, ni lasser leur fécondité !
Tout ceci, n’est point, qu’on y songe bien, amplification de rhétorique, et je n’y ai point vu matière à style. J’ai voulu seulement, à l’honneur de la population que j’ai entrepris de faire connaître, résumer à grands traits et comme en un tableau, les péripéties de cette pêche d’Islande, qu’on ne connaît pas assez dans le public. Si le tableau pèche, c’est parce qu’il est au-dessous de la réalité.
Je termine par quelques réflexions que je livre aux méditations de mes lecteurs.
Si l’on a pu, à un certain point de vue, comparer l’homme à une machine, et l’estimer d’après son rendement c’est-à-dire, d’après le rapport de ce qu’il dépense à ce qu’il produit, quel n’est pas, je le demande, le rendement social du petit groupe qui nous occupe ?
Sobre, prolifique, ardent à la peine, ne rend-il pas à la société dont il fait partie politiquement, cent fois plus qu’elle ne lui donne, lui qui fournirait à notre flotte, en temps de guerre, d’intrépides marins, et qui fournit au pays, en temps de paix, les infatigables et hardis pourvoyeurs d’une de ses meilleures industries?
Partant de là, pourquoi l’Etat, reprenant à son compte la grande pensée de Louis XIV, ne favoriserait-il point de tout son pouvoir le développement de populations exclusivement maritimes, soit par une organisation analogue à celle que nous avons décrite, soit par quelques privilèges qui seraient en définitive, encore moins que l’égalité ?
N’v a-t-il plus sur les deux à trois mille kilomètres qui sont les côtes de France, des terres plus ou moins incultes que l’Etat pourrait acquérir à bon compte et concéder ensuite à des familles qui se voueraient exclusivement à la pêche ? N’y aurait-il point là un moyen d’enrayer, au moins dans une certaine mesure, le mouvement déplorable à tous égards qui se produit vers certains centres, et de multiplier sur notre sol les races fortes et fécondes ?
Au moment où j’écris ces lignes la consternation règne à Fort-Mardyck. La Virginie, barque qui porte 18 Fort-Mardyckois n’a pas été vue depuis le départ, c’est-à dire, depuis le mois de mars, ce qui est, au dire des vieux, d’un très grave pronostic.
Ce matin, 4 juin, le hasard a voulu que je fisse, à l’entrée du village, la rencontre du facteur, lequel apportait des lettres d’Islande. C’était, je crois, le 3e courrier depuis le départ en mars. Il m’est impossible de décrire la scène que j’eus sous les yeux ; cent femmes se précipitant haletantes vers cet homme qui apportait des nouvelles de là-bas, lui criant leurs noms d’une voix mal assurée, dévorant en quelque sorte les lettres salies qu’on leur tendait, avec plus d’avidité qu’un affamé d’un morceau de pain. Puis, lorsqu’une fois de plus, toutes les lettres lues, personne ne put donner des nouvelles de la Virginie, je vis cinq ou six femmes se détachant du groupe principal, et s’éloigner la tête dans leurs mouchoirs, en étouffant des sanglots.
Cette scène me remua profondément, et je continuai ma route en me disant que mon Islande à moi, celle que j’avais présentée au lecteur dans un tableau que j’avais cru fidèle, n’était qu’une Islande à l’eau de rose, et en tout cas, bien inférieure à la réalité.
Si nous nous sommes étendu avec une certaine complaisance sur cette notice historique, ce n’est pas simplement pour faire connaître une population sympathique au lecteur, ou pour satisfaire la légitime curiosité de ceux qui s’intéressent à l’histoire locale de l’arrondissement de Dunkerque.
Notre but principal était, dans ces temps où les questions économiques et sociales préoccupent tous ceux qui sont soucieux de l’avenir du pays, de faire connaître une population vivant sous un régime économique tout particulier, régime économique basé sur la petite propriété rendue inaliénable et inextensible.
Nous estimons que ce régime économique a exercé une influence souverainement moralisatrice sur lu population de Fort-Mardyck, et notre appréciation est basée sur la connaissance approfondie que nous avons d’autres populations qui vivent, semblables en tout et pour tout, de par ailleurs, a celle de Fort-Mardyck, et qui n’en diffèrent, que par leur régime économique, et par une moralité moins élevée. Nous pourrions citer à ce sujet, les populations maritimes du littoral de Gravelines, du Courgain à Calais.de Berck, et du Havre.
L’histoire économique de Fort-Mardyck tentera-t-elle quoiqu’un de nos lecteurs plus compétent que nous à ce point de vue ! Nous le voudrions.
En attendant, nous croyons devoir donner sur le régime économique de celle commune quelques détails qui n’ont pu trouver place dans la notice historique.
Créé, par la volonté de Louis XIV dans un but d’intérêt général, celui de fournir une pépinière de marins intrépides à la France, le régime économique de Fort-Mardyck, après bien des assauts dus à la haine ou à l’envie des communes voisines s’est trouvé confirmé d’une manière définitive, en 1847, par l’approbation du préfet du département du Nord.
Ce régime économique repose essentiellement sur les bases suivantes : Le territoire de Fort-Mardyck appartient aux marins-pêcheurs, et ledit territoire ne pourra être occupé « que par des gens qui, par leur seule résidence, deviendront sujets aux classes c’est-à-dire à l’inscription maritime (ordonnance royale du 3 septembre 1785)
Ce territoire est administré par des receveurs et une commission syndicale ; celle- ci constituée par cinq membres élus partout les matelots-pêcheurs âgés de 21 ans chefs de famille ou de maison, et jouissant de leurs droits civils et politiques. La commission syndicale est renouvelable par cinquième. Los fonctions principales de la commission syndicale sont : 1. de surveiller la gestion des receveurs ; 2. de conserver à l’abri de toute usurpation les biens de la concession, etc. (Règlement de l’association des marins-pêcheurs de Fort-Mardyck, approuvé par l’autorité préfectorale à Lille le 5 novembre 1847).
Une parcelle de ce territoire est donnée en usufruit à toute famille de marins-pêcheurs, nés, s’établissant, et demeurant à Fort-Mardyck. L’article 12 de la délibération confirmative des usages antérieurs de la commission syndicale en date du 9 octobre 1858, délibération approuvée par l’autorité préfectorale, est ainsi conçu :
« Les concessionnaires ne pourront concéder qu’à leurs enfants seulement les parcelles de terre qu’ils occupent — Dans aucun cas la parcelle cédée ne pourra être scindée. »
Deux conséquences très importantes découlent de celle disposition :
1. Les terrains concédés sont à l’abri des créanciers : le bénéficiaire est certain de jouir sa vie durant des produits de son chétif domaine,
2. En limitant aux enfants le droit de concession et en interdisant le morcellement, on assure par la même, la transmission intacte du terrain concédé,
Ce fait est précieux à noter à cette époque où le morcellement de la petite propriété préoccupe à juste titre nos économistes les plus célèbres (voir la Réforme sociale et les ouvrages de M. Le Play).
On voit quel intérêt présente, au point de vue social, l’étude économique de Fort-Mardyck, et nous nous demandons s’il n’y aurait pas lieu d’établir un régime analogue pour les mineurs qui exploitent les fosses à charbon ?
D’autre part, quand le Dr Bertillon incrimine la petite propriété comme cause de l’affaiblissement de notre natalité (Revue scientifique, 1875), n’est-il pas intéressant de mettre en relief combien la petite propriété inaliénable et inextensible donne des résultats différents de ceux que donne la petite propriété, soumise au régime économique qui régit actuellement la France entière ?
[1] L’autre partie dépendait de Grande-Synthe ; mais les registres de la paroisse de Grande-Synthe correspondant à la même période, ayant disparu dans un incendie, il n’est oas possible de fixer le chiffre exact de la population du hameau à cette époque.
[2] Archives de la mairie de Dunkerque.
[3] L’acte authentique, rédigé en conseil d’Etat (1785), qui les rétablit dans leurs droits, est aux archives de la marine, à Paris. On peut en voir la copie dans la salle de la mairie de Fort-Mardyck.
[4] Nous affirmons ce fait sur la foi de l’historien de Mardyck ; mais le hameau des Matelots-Pêcheurs ne dut pas tarder à faire de nouveau partie de Grande-Synthe et de Petite-Synthe, communes auxquelles nous le trouvons rattaché, quand lui-même fut de nouveau et définitivement érigé en commune en 1867. Nous apprenons au dernier moment que c’est en 1830 que Fort-Mardyck fit retour à Grande-Synthe et Petite-Synthe.
[5] Ce mouvement de recul s’explique par la désastreuse campagne d’Islande en 1839.
[6] Et c’est pour cela que l’hospice des Vieux-Marins a été élevé à Bray-Dunes, sur une portion de la côte distraite de la commune agricole de Ghyvelde.