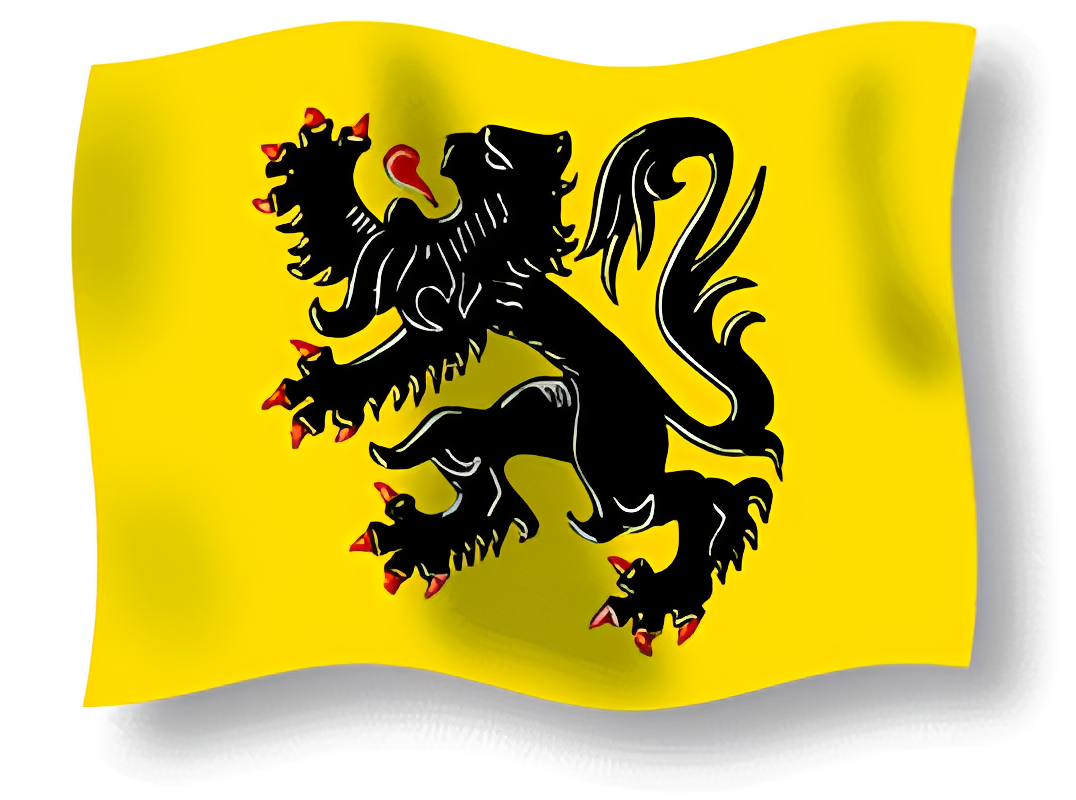Quatre jours en Flandre avec Edith Wharton (20-23 juin 1915)
Romancière et nouvelliste américaine reconnue, installée à Paris depuis 1907, Edith Wharton s’engage dès le début de la Grande Guerre à aider les populations civiles obligées de fuir les zones de combats. Elle obtient en 1915 l’autorisation de se rendre sur le Front accompagné d’un chauffeur et d’un ami. Elle publiera pour le Scribner’s magazine plusieurs articles relatant ses voyages de Dunkerque à Belfort. L’un de ces voyages l’amène dans la Flandre française et notamment à Cassel et Dunkerque.
Nous publions des extraits de ce récit qui nous donne un bref aperçu de la vie à l’arrière-front en Flandre : le cantonnement des troupes, les relations de ces dernières avec la population locale, les bombardements soudains, les évacuations des civils.
20 juin 1915.
La ville dont nous approchions aurait pu, dans un rêve étrange, évoquer à la fois le souvenir de Winchelsea et de San Gimignano : mais dès que nous eûmes franchi les portes de Cassel nous fûmes si pénétrés de sa personnalité que l’idée ne nous vint plus de la comparer à aucune autre ville.
Ce fut sans surprise que nous lûmes dans notre guide que Cassel était la ville d’Europe d’où l’on jouissait de la vue la plus étendue.
Qu’y a-t-il de mieux qu’un horizon sans limites pour faire valoir la beauté d’une cité resserrée dans une étroite ceinture de vieilles murailles ?
Notre hôtel était sur l’exquise petite place du Marché avec un hôtel de ville Renaissance d’un côté, et, de l’autre, un palais espagnol en miniature, avec une façade de briques rosées ornée de sculptures grises.
La place était encombrée d’automobiles militaires anglaises et de beaux chevaux qui se cabraient d’impatience. Le restaurant était bondé d’officiers en khaki savourant leur thé sans paraître se soucier du paysage.
Quelle tristesse de constater encore une fois que la guerre et tout ce qui s’y rattache, sauf la mort et la destruction qu’elle entraîne, exalte le sens de la vie, et que les visions guerrières fascinent et stimulent à la fois ! « C’était gai et terrible » est une phrase qui revient à tout instant dans la Guerre et la Paix ; et la gaieté de la guerre éclatait partout dans la petite ville endormie de Cassel, qu’elle transfigurait en la remplissant du cliquetis des armes et des rires d’une jeunesse virile.
Du parc situé au sommet de la ville nous jouissions d’une autre vue : la plaine s’étendait à l’infini, se perdant dans les brouillards de la mer, et au loin, à travers la brume, on apercevait des villes et des clochers noyés dans la torpeur de l’été. Pendant un moment, tandis que nous les regardions, la vision de la guerre se dissipa comme un décor que l’on change. Mais tout s’assombrit de nouveau pour nous en entendant certains noms prononcés par les soldats anglais appuyés sur le parapet à côté de nous : « Là-bas, c’est Dunkerque », dit l’un d’eux, en nous désignant un point avec sa pipe – « et ici, Poperinghe, juste au-dessous de nous. Furnes est là derrière, et Ypres et Dixmude et Nieuport. » Il nous sembla voir planer sur le paysage ensoleillé l’ange du mal qui porte la mort dans l’ombre de ses ailes…
Plus tard nous remontâmes sur le rocher de Cassel. C’était un soir de pleine lune ; et comme les civils n’ont pas le droit de sortir seuls la nuit, un officier d’état-major vint avec nous pour nous montrer la vue que l’on découvre du toit du ci-devant casino, tout au sommet du rocher.
Sensation vraiment étrange, après avoir poussé une porte vitrée, que de se trouver dans une vaste salle peinte, et d’apercevoir, dans le mystère du clair de lune, des soldats endormis sur les parquets cirés, tout leur attirail empilé sur des tables de jeux !
Nous traversâmes un grand vestibule, où d’autres soldats dormaient dans la demi-obscurité, et, par un long escalier, nous arrivâmes jusqu’au toit. Une sentinelle nous interpella, puis nous laissa passer. La masse sombre de la ville était à nos pieds. Au nord-ouest, une colline escarpée, le Mont des Cats, se dessinait sur le ciel. Rien d’autre ne coupait la ligne de l’horizon, baigné dans la brume et le clair de lune. La silhouette des villes ruinées s’était évanouie, et la paix semblait avoir reconquis le monde. Mais pendant que nous étions là s’élança du brouillard au nord-ouest, une lueur rouge bientôt suivie de plusieurs autres surgissant de différents points éloignés. « Ce sont des bombes lumineuses au-dessus des lignes, » nous expliqua notre guide – et, à ce moment même, plus loin, une lumière blanche s’épanouit comme une fleur tropicale, pour disparaître ensuite dans la nuit. « Une fusée », nous dit-on ; et une autre grande lueur fleurit plus bas. À nos pieds, Cassel dormait de son bon sommeil provincial : le clair de lune éclairait ses toits et les arbres de ses jardins, tandis qu’au loin ces fleurs infernales continuaient à s’ouvrir et à se fermer dans le royaume de la mort…
21 juin 1915
Sur la route de Cassel à Poperinghe. Dans la poussière et la chaleur, dans la confusion de la foule et l’agitation de l’arrière-garde en temps de guerre. La route traverse la plaine, toujours bordée des mêmes haies toutes blanches de poussière et labourée par le passage incessant des innombrables camions automobiles, des voitures chargées de munitions et des ambulances de la Croix-Rouge. Dans l’intervalle, voici des détachements d’artillerie anglaise, avec grand tapage de caissons. Puis défilent, montés sur des chevaux luisants, de jeunes héros de Phidias. Leur jeunesse est si fraîche et si radieuse qu’on se demande comment ils ont pu regarder en face les horreurs de la guerre et jouir encore de la vie. Malgré la poussière, chevaux et cavaliers ont l’air de sortir du bain. Tout le long de la route on voit des camps improvisés, des tentes faites avec des bâches. Des chemises sèchent sur les haies, de l’eau bout sur de grands feux, des hommes se rasent, cirent leurs chaussures, astiquent leurs fusils, graissent leurs selles, polissent leurs étriers et leurs mors. De tous les côtés, c’est une lutte organisée contre la poussière et le désordre. Un jeune soldat appuyé contre la palissade d’un jardin cause avec une jeune fille au milieu des roses trémières. Un vétéran s’amuse à enseigner à un groupe d’enfants les besognes de la vie des camps. Partout on est frappé de voir s’établir les mêmes relations amicales et spontanées entre les soldats et les propriétaires des champs et des jardins.
…
À la fin du jour, nous arrivâmes à Dunkerque qui s’étendait paisible entre son port et ses canaux. La ville s’était complètement vidée après le bombardement du mois de mai : aucun dégât n’était apparent, et pourtant on sentait partout la même atmosphère maudite. Place Jean-Bart tous les magasins étaient fermés et les cafés déserts, mais l’hôtel restait ouvert. L’idée nous vint que Dunkerque serait un centre commode pour les excursions que nous projetions. Nous décidâmes donc d’y revenir le lendemain soir. Puis, nous repartîmes pour Cassel.
…
22 juin 1915
Au réveil, ma première pensée fut : « Comme le temps passe ! Ce doit être le 14 juillet ! » Je me soulevai dans mon lit en entendant le canon, et peu à peu je me rendis compte que j’étais à l’auberge de l’Homme Sauvage, à Cassel, et que nous étions le 22 juin.
Mais, alors, quoi ? Un taube, sans doute ! Et tous les canons de la place le bombardaient ! En faisant ces réflexions, je m’étais à peu près habillée, j’avais dégringolé l’escalier, tiré les lourds verrous de la porte, et je m’étais élancée sur la place. Il était quatre heures du matin : le moment le plus exquis d’une aurore d’été. Malgré le bruit, Cassel semblait encore endormie. Quelques soldats seulement étaient sur la place. Ils me montrèrent dans le ciel pur un petit nuage blanc derrière lequel, me dirent-ils, un taube venait de disparaître. Évidemment Cassel était blasée sur les taubes et je sentis que mon émoi exagéré n’était pas de saison : je me glissai dans l’hôtel et regagnai ma chambre. Dans l’escalier, je m’arrêtai pour regarder, par une fenêtre, les lignes des toits de la ville et les jardins descendant vers la plaine. Tout à coup, une autre détonation retentit et un panache de fumée blanche s’éleva des arbres fruitiers juste sous la fenêtre. C’était un dernier coup tiré sur le taube fugitif par un canon caché dans l’un de ces tranquilles jardins provinciaux, entre les maisons voisines ; sa présence si proche, si bien dissimulée, m’impressionna plus vivement que tout le fracas des mitrailleuses de la forteresse.
Cassel retomba dans le calme de son sommeil ; mais une ou deux heures après, dans le silence, éclata un bruit effroyable comme le son de la trompette du jugement dernier. Cette fois, il ne pouvait pas être question de mitrailleuses. L’Homme Sauvage trembla sur sa base et toutes les vitres de mes fenêtres furent ébranlées. D’où pouvait venir ce bruit incroyable et inconnu ? Cela ne pouvait être que la voix puissante du gros canon de Dixmude ! Cinq fois, pendant que je m’habillais, ce tonnerre secoua mes fenêtres, et l’air vibra d’un bruit que je ne puis comparer – si tant est que l’imagination humaine puisse en supporter l’effort – qu’à celui de tous les rideaux de fer de tous les magasins du monde se fermant tous à la fois. Chose étonnante ! L’Homme Sauvage et ses habitants n’en paraissaient pas autrement affectés. Je fis ma toilette, préparai mon bagage et bus mon café comme si de rien n’était, dans l’intervalle de ces effroyables coups de tonnerre.
Nous partîmes de bonne heure pour un état-major du voisinage, et ce n’est qu’en sortant des portes de Cassel que nous vîmes les effets du bombardement : une usine à gaz pulvérisée et un champ de choux transformé en un cratère du Vésuve. Il était assez consolant de constater la grotesque disproportion entre le bruit des bombes et le dommage causé par elles.
Nous eûmes, au quartier général, des détails sur les incidents du matin. On nous dit que Dunkerque avait d’abord été visitée par le taube qui vint repérer Cassel ; le grand canon de Dixmude avait ensuite tourné toute sa rage contre le port français. Le bombardement de Dunkerque continuait ; et on nous pria, on nous ordonna même, de renoncer à y retourner ce soir.
Après déjeuner, nous continuâmes vers le nord, du côté des dunes. Tous les villages que nous traversions étaient évacués : les uns complètement vides et morts, les autres occupés par les troupes. Bientôt nous vîmes un groupe d’automobiles militaires rangées le long de la route, et nous aperçûmes un champ où manœuvraient des troupes. « C’est l’amiral Ronarc’h » nous dit l’officier qui nous accompagnait ; et nous comprîmes que nous avions eu la bonne fortune de nous trouver là au moment où le héros de Dixmude passait en revue les fusiliers marins et les territoriaux dont la magnifique défense avait ajouté de nouveaux lauriers à toutes les gloires de cette ville tant de fois assiégée.
Nous arrêtâmes la voiture et montâmes sur un talus qui dominait le champ. Il faisait grand vent et on entendait distinctement le son du canon venant du front. Le soleil, à travers les nuages de sable que le vent soulevait, éclairait des prairies pâles, de grandes étendues sablonneuses et des moulins à vent gris. On ne voyait rien dans ce désert que cette poignée d’hommes défilant devant les officiers au bord du champ. L’amiral Ronarc’h en grand uniforme, ganté de blanc, se tenait un peu en avant, un jeune officier de marine à ses côtés. Il venait de distribuer des médailles à ses fusiliers et à ses territoriaux, et ceux-ci défilaient devant lui, drapeaux déployés, musique en tête. Chacun de ces hommes était un héros, et il n’y en avait pas un qui n’eût vu des horreurs à faire frissonner les plus braves. Ils avaient perdu Dixmude – pour un moment – mais avaient gagné une gloire immortelle, et l’âme de leur résistance épique avait été cet officier d’aspect tranquille que nous voyions là, droit et grave, en grand uniforme et en gants blancs.
Il faut avoir été dans le nord pour comprendre les liens étroits qui unissent, dans ce pays où le combat est continuel et acharné, les soldats et les officiers qui les commandent. Le sentiment du chef pour ses hommes est presque de la vénération, celui des soldats une tendresse enjouée pour ces officiers qui ont partagé tous leurs dangers. Ce sentiment réciproque se traduit par mille signes insaisissables, mais rien ne l’exprime mieux que la manière dont les officiers prononcent ces deux mots qui reviennent sans cesse sur leurs lèvres : « Mes hommes. »
…
23 juin 1915
Avant déjeuner, l’automobile nous ramène à Dunkerque le long du canal, entre des plaines verdoyantes et des villages florissants. Rien n’y rappelait la guerre, sauf les camions militaires et les voitures d’ambulances qui sillonnaient la route. Les murs et les portes de Dunkerque nous apparurent aussi intacts que lorsque nous y entrâmes avant-hier ; mais à l’intérieur des portes c’était un désert. Le bombardement avait cessé la veille au soir, laissant la ville dans un silence de mort. Toutes les maisons étaient fermées, les rues étaient vides. Nous allâmes à la place Jean-Bart à l’endroit même où, deux jours auparavant, nous prenions le thé dans le hall de l’hôtel. Maintenant, il ne restait plus un carreau aux fenêtres du square, les portes de l’hôtel étaient fermées, et l’on voyait, de temps en temps, un domestique apparaître, portant un panier rempli des plâtras tombés des plafonds. Le square était littéralement pavé de morceaux de verre provenant des innombrables vitres cassées – et, juste au pied de la statue de Jean Bart, à l’endroit même où l’automobile nous attendait l’autre jour, le canon de Dixmude avait creusé un trou qui rivalisait avec le cratère de Nieuport.
Bien que toutes les maisons de la place fussent intactes, elle avait un air d’absolue désolation. C’était la première fois que nous voyions les blessures fraîchement causées par un bombardement. Ce ravage si récent n’en paraissait que plus cruel encore. En suivant une rue derrière l’hôtel, nous arrivâmes à l’élégante église gothique de Saint-Éloi, dont un bas côté a été en partie saccagé. Puis, nous nous trouvâmes en face d’une pauvre maison bourgeoise entièrement dépouillée de sa façade. Ces planchers effondrés, exposés à nos yeux dans leur nudité vulgaire, ces armoires éventrées, ces lits suspendus dans le vide, ces couvertures en tas, cet amas de chaises renversées, de poêles, de lavabos sens dessus dessous, étaient bien plus pénibles à voir que les nobles blessures de l’église. Saint-Éloi était drapée dans la dignité du martyre : la pauvre petite maison faisait penser à quelque personne timide et gauche, soudainement exposée au grand jour dans le déguenillement de sa misère.
Quelques groupes regardaient les ruines ou erraient sans but dans les rues. Tout le monde parlait bas, comme dans une chambre mortuaire : c’était plus impressionnant que le silence absolu d’Ypres. Pourtant, quand nous revînmes à la place Jean-Bart, l’instinct de vie qui résiste à tout avait déjà commencé à reparaître : une bande d’enfants jouait au fond du cratère, à la recherche de « spécimens » de verre cassé et de briques fendues ; et, tout autour, tranquillement comme d’habitude les gens du marché dressaient leurs petits étalages de bois. Dans quelques minutes les traces de l’obus allemand seraient cachées sous des tas de faïences et d’ustensiles déménagé, et ces mêmes femmes que nous avions vues absorbées dans la douloureuse contemplation des ruines retrouveraient leur entrain accoutumé pour marchander une casserole ou une bassinoire.
12 juillet 1562, un prêche protestant à Boeschèpe
Les tours de l’ancienne abbaye Saint-Winoc de Bergues